OLIVIER MOSSET
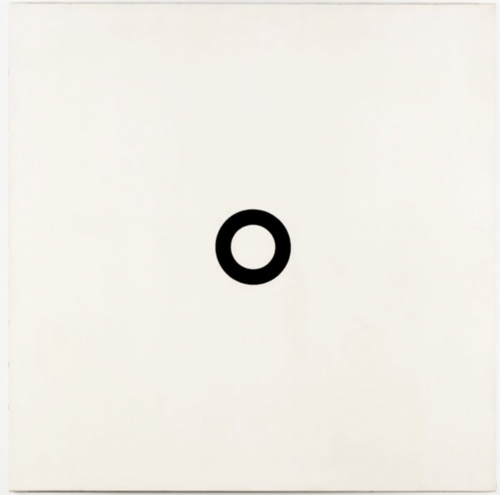
Biographie
OLIVIER MOSSET
À Genève, le Mamco consacre une rétrospective à Olivier Mosset. Rencontre avec l’auteur du Cercle noir sur fond blanc, dont l’approche de la peinture n’a presque pas changé depuis ses débuts en 1964.
Je ne m’en suis pas occupé. Ce sont Lionel Bovier, directeur du Mamco [musée d’Art moderne et contemporain], et Paul Bernard, conservateur, qui ont tout géré en se concentrant principalement sur mes peintures, mais aussi en choisissant des œuvres d’autres artistes avec lesquels j’ai collaboré. Ils ont réalisé un travail incroyable en trouvant certaines pièces que j’avais complètement oubliées. Je ne sais plus où sont toutes mes œuvres. En fait, je n’aime pas parler de tout ça. Je suis vieux, vous savez, quasiment à la retraite.
Vous dites ne pas aimer parler de votre travail. Pourtant, une fois que vous êtes lancé, vous êtes intarissable.
Je n’aime pas non plus être pris en photo. Les expositions, par contre, j’aime beaucoup. C’est un moyen de voir le travail dans son entier et de comprendre de quoi il s’agit.
Comment cela ?
Le sens de ma peinture apparaît après coup. Sur le moment, je ne me dis pas que répéter des toiles avec un cercle noir sur un fond blanc traduit une critique de l’œuvre unique ou que peindre des toiles rayées est un moyen de mettre en crise le principe de la signature. J’ai la même attitude envers les travaux des autres. Lorsque je regarde un Rothko, j’imagine ce qu’il a voulu faire, mais je me trompe peut-être sur son intention.
Vous avez dit: « L’avantage de mon métier, c’est que lorsque je me lève le matin, je sais de quoi ma journée sera faite. » Être artiste, ce n’est pas une profession sérieuse ?
Ah si, la peinture, c’est très sérieux. Mais, chez moi, cela participe au départ d’une difficulté à exprimer les choses au moyen du langage. Lorsque j’étais au gymnase [l’équivalent suisse du lycée en France], je m’intéressais à la littérature et à la poésie, à des auteurs comme Stéphane Mallarmé. Puis un jour, ma mère m’emmène voir une exposition collective à la Kunsthalle de Berne, où étaient présentées des œuvres de Robert Rauschenberg. J’avais 17 ans et je me souviens de sa sculpture Monogram,qui représente une chèvre avec un pneu autour du ventre. Je me suis dit : si ça, c’est de l’art, alors on peut tout faire. C’est vraiment ce qui m’a poussé à devenir artiste. Et aussi le fait que le plafond de ma chambre d’enfant était peint de scènes de la Bible en grisaille. J’étais fasciné par Adam et Ève chassés du paradis. À l’occasion de mon exposition à la Kunsthalle de Berne en 2011, quelqu’un avait réussi à retrouver l’appartement. Le décor était toujours là. J’en ai reproduit certains éléments en photographie pour en faire une édition.
« pendant six mois, Buren, Parmentier, Toroni et moi parlons beaucoup et théorisons les concepts de la répétition et de l’absence de signature. »
À 17 ans aussi, vous décidez de partir travailler à Paris chez Jean Tinguely…
Je suis arrivé à Paris en 1963, avec la ferme intention de faire de l’art. Dans un café, j’ouvre un annuaire et, à la rubrique « Artistes », je tombe sur Jean Tinguely. Il travaillait impasse Ronsin, où se trouvait aussi l’atelier de Constantin Brancusi. Je vais le voir, et il m’engage. Au début, je devais surtout l’accompagner sur les chantiers pour aller chercher de la ferraille. Mais nous parlions beaucoup. C’est à cette époque que je fais mes débuts d’artiste. Ma première pièce ressemblait un peu à du Rauschenberg. À la suivante, j’ai intégré des bouteilles cassées et des cigarettes. On sentait l’influence du Nouveau Réalisme. C’était aussi le moment où Niki de Saint Phalle, la deuxième femme de Tinguely, tirait à la carabine sur des ballons remplis de peinture qu’elle accrochait sur des toiles blanches. Je me disais qu’avant qu’ils ne soient éclaboussés, ces tableaux sans rien étaient très bien aussi. J’ai alors commencé à créer des pièces blanches. Je peignais des paquets de cigarettes blancs qui avaient un petit côté Donald Judd. J’ignore d’où m’est venue cette idée. Il n’y avait pas vraiment de magazine d’art. Kasimir Malevitch et le Minimal Art, je les ai découverts plus tard. Sans doute y avait-il quelque chose dans l’air en réaction à l’expressionnisme abstrait américain.
1963, c’est aussi la date de votre toute première exposition.
Oui, à Neuchâtel, une exposition d’étudiants. Après avoir travaillé pour Tinguely, je suis retourné en Suisse. Mes parents m’avaient inscrit dans une école privée où je n’allais presque jamais, car je préférais passer le plus clair de mon temps au cinéma. J’ai exposé deux toiles qui n’existent plus. J’avais écrit « The End » sur la première et « R.I.P. » sur la seconde. En 1964, je retrouve Tinguely à Lausanne, alors que la Confédération lui a commandé une grande sculpture pour l’Exposition nationale suisse. Il m’embauche pour travailler avec lui sur cette sculpture, Eureka. En Suisse, Tinguely n’était pas encore célèbre. C’est grâce à cette exposition qu’il est devenu dans son pays presque l’égal de Picasso. Juste après avoir passé ma maturité [l’équivalant suisse du baccalauréat], je le rejoins à Paris. Je deviens son apprenti pour des raisons liées à une assurance-vie que m’a laissée mon père, décédé quelques années auparavant. J’assiste également Daniel Spoerri, et je peins des toiles avec un « A » majuscule.
En 1966, vous peignez un cercle noir sur fond blanc. Quelles ont été les circonstances de la création de ce motif devenu iconique ?
J’avais un ami à Neuchâtel qui s’appelait Jacques Sandoz, qui réalisait des films. Il m’a demandé une toile qui pourrait servir dans le décor de l’appartement où il tournait. Je lui ai donné ce cercle noir peint sur une toile blanche de format carré. C’est dans ce court métrage, intitulé It’s my life (and I do what I want), qu’on la voit pour la première fois. J’en ai ensuite vendu une au critique Otto Hahn, qui était venu dans mon atelier à Paris. Quelque temps plus tard, deux autres, à Yvon Lambert et à Rudolf Zwirner, le père du galeriste David Zwirner. Mais c’est à la galerie Rive Droite [Paris], fin 1968, que j’expose pour la première fois une série de cercles noirs.
Yvon Lambert, Otto Hahn, Rudolf Zwirner… Comment expliquez-vous le succès auprès de ce public très connaisseur d’une toile peinte par un jeune artiste de 22 ans ?
Je ne sais pas. Il y avait une espèce d’ouverture. Le fait de répéter ce cercle évoquait le travail d’Andy Warhol à New York, même si, en fait, lui ne répétait pas vraiment. Le côté boring de ces œuvres intéressait peut-être les gens.
On a dit aussi qu’elles représentaient le « O » d’Olivier ou le degré zéro de la peinture…
Et qu’après le « A », j’avais fait un « O ». Mais c’est plus compliqué. En 1966, je n’ai pas encore vu les peintures de Malevitch, mais je connais le travail de Jasper Johns, de Morris Louis et de Kenneth Noland, que j’ai vu à la Biennale de Venise de 1964. Avant le cercle, j’ai peint des toiles avec des points ou juste une ligne, comme des sortes de Barnett Newman qui auraient basculé à l’horizontale. Je me souviens qu’au moment de l’Exposition nationale de 1964 avait été organisée au palais de Rumine, à Lausanne, une exposition sur l’art dans les collections suisses. Dans un coin, au milieu des Picasso et des Renoir, était accroché un tableau de Piet Mondrian. J’ai trouvé ça presque subversif. Je crois que c’est à ce moment-là que je me suis dit qu’avec la peinture abstraite, tout est possible.
Salvador Dalí est aussi venu à votre vernissage à la galerie Rive Droite. Comment était-il ? Qu’est-ce qui l’intéressait chez vous alors que vous ne faisiez pas exactement la même peinture ?
Il était très généreux et au courant de ce qui se passait. Il m’a invité à venir le voir dans la suite qu’il occupait à l’hôtel Meurice. Un jour, en passant devant, je suis monté. Nous avons parlé de ce que je faisais, de Malcolm Morley dont il connaissait parfaitement le travail alors que ce n’était pas encore un artiste très connu, de Warhol et de Vermeer bien sûr. Le plus amusant, c’est qu’en privé, il parlait français sans aucun accent. C’est lors de ses apparitions en public qu’il entrait dans son personnage.
Vous avez aussi rencontré Marcel Duchamp…
Il est venu à la manifestation que nous avions organisée, Daniel Buren, Michel Parmentier, Niele Toroni et moi-même, au musée des Arts décoratifs. Mais je ne lui ai pas vraiment parlé. C’est plus tard, à l’occasion de son exposition avec [Raymond] Duchamp-Villon, que j’ai osé lui adresser la parole. Il se trouvait seul dans l’exposition. Je lui ai demandé s’il en était content, histoire d’engager la conversation. Il m’a répondu : « Oui, je suis très content… » Et il a tourné les talons.
Buren, Parmentier et Toroni justement. Comment vous êtes-vous rencontrés ?
En 1966, Otto Hahn me dit qu’un peintre veut me parler. Il s’agit de Buren, qui a vu mon cercle accroché chez lui. Il participe alors avec Parmentier à une exposition collective à la galerie Jean Fournier. Ce que j’y vois m’impressionne fortement. Buren et Parmentier me présentent ensuite Toroni. Tous ensemble, nous voulions que les choses bougent dans l’art. Pendant six mois, nous parlons beaucoup et théorisons les concepts de la répétition et de l’absence de signature.
« John Armleder m’a “remis” en Suisse. Sans lui, cette rétrospective au Mamco n’existerait pas. Quand j’étais à Paris, je ne criais pas sur tous les toits d’où je venais et, en Suisse, personne ne savait vraiment ce que je faisais. »
Puis vous mettez le concept en pratique. Le « groupe » tient neuf mois avant de se séparer. Pourquoi ?
En fait, cela fonctionnait entre nous tant que nous parlions. Dès que nous avons appliqué la théorie, revendiquant mutuellement les toiles des uns et des autres, les choses se sont compliquées. Buren se plaint toujours en disant que le groupe BMPT n’a jamais existé. Ce qui est en partie vrai, car le nom est en effet l’invention d’un journaliste. Reste que nous avons utilisé le terme « groupe » une fois, lors de notre séparation : dans un tract, en 1967, Parmentier écrit que « le Groupe Buren – Mosset – Parmentier – Toroni n’existe plus ». C’est à ce moment-là que nous nous fâchons un peu. Parmentier arrête tout. Buren et Toroni exposent à Lugano, où ils demandent aux visiteurs de faire les tableaux. Mais je ne suis pas invité. Après, nous avons exposé tous les trois une dernière fois à Lyon.
S’ils n’ont pas réussi avec Buren, Toroni et Parmentier, l’échange et la collaboration fonctionnent bien en revanche avec Steven Parrino et Cady Noland. Et surtout, depuis des années, avec John Armleder, dont vous êtes très proche. Comment l’expliquer ?
John Armleder m’a « remis » en Suisse. Sans lui, cette rétrospective au Mamco n’existerait pas. Quand j’étais à Paris, je ne criais pas sur tous les toits d’où je venais et, en Suisse, personne ne savait vraiment ce que je faisais. J’ai rencontré John à l’époque où il tenait sa petite galerie, Ecart, à Genève. Je n’étais pas forcément fan des artistes Fluxus qu’il exposait et que je ne prenais pas vraiment au sérieux, mais lui était passionnant. Notre première collaboration a été une rampe de skate que nous avons installée à la Biennale de Lyon en 1993. Ensuite, il y a eu les expositions à trois avec Sylvie Fleury. Nous nous appelions AMF. Les initiales de nos trois noms forment aussi l’acronyme d’American Machine and Foundry, un fabricant de matériel de bowling ayant participé à la production de Harley-Davidson, et sont bien sûr un clin d’œil ironique à BMPT. John est un artiste très important. Si, d’une certaine manière, je suis l’un des derniers modernes, lui est l’un des derniers postmodernes.
Il y a eu ensuite Mai-68, un événement qui vous marquera durablement. Qu’espériez-vous ?
Que le monde change, comme tout le monde. Et que l’art change le monde. Un peu bêtement, j’ai dit à ce moment-là qu’en 1915, Malevitch a peint le Carré noir sur fond blanc, deux ans avant la Révolution russe. Et que moi, en 1966, je faisais des cercles noirs sur fond blanc, deux ans avant Mai-68. J’ai été arrêté, une seule fois. C’était après les événements, vers la fin de l’année. J’ai été interrogé à un assez haut niveau. Lorsque j’ai demandé le renouvellement de ma carte de séjour, dans les années 1970, on me l’a refusé. Je suis donc revenu en Suisse pour mieux repartir à New York en 1977. Les gens parlaient des artistes conceptuels. C’était là-bas que les choses se passaient.
Que connaissiez-vous de l’art contemporain américain ?
Peu de choses. En 1967, j’avais accompagné Tinguely et Niki à l’Exposition universelle de Montréal, où ils ont réalisé Le Paradis fantastique, un ensemble de sculptures monumentales installé sur le toit du Pavillon français. J’en avais profité pour aller à New York, où j’avais découvert les peintures de Malevitch au MoMA [Museum of Modern Art] et les toiles de Robert Ryman. Je me souviens avoir trouvé cela intéressant, mais sans plus. Je me disais : tiens, d’autres artistes font comme nous. J’ai aussi rencontré Andy Warhol pour la première fois.
Qui signera d’ailleurs une de vos toiles…
Bien plus tard, en 1985. Nous nous entendions bien, même si c’était quelqu’un de difficile à saisir. Lors d’une soirée à laquelle je ne participais pas, quelqu’un lui a conseillé d’entamer une collaboration avec moi. Il a répondu : d’accord, faisons cela tout de suite. Il a pris un de mes monochromes jaunes qui était accroché là, et l’a signé et daté.
À quoi ressemblait la scène artistique new-yorkaise à la fin des années 1970 ?
C’était le grand retour de la figuration, à travers des artistes comme David Salle, Julian Schnabel, Georg Baselitz et toute la Trans-avant-garde italienne. Je me dis qu’un type comme moi, qui peint de grandes toiles rouges, aura des problèmes. C’est pourquoi je m’inscris en 1980 au département d’art visuel et d’histoire de l’art à la Columbia University. Pour une histoire de visa, mais aussi dans le but de devenir enseignant. Lorsque j’en sors diplômé, en 1983, le monde de l’art est en train de changer. On parle toujours de Jean-Michel Basquiat et de Keith Haring, mais le Néo-Géo est arrivé et la Radical Painting de Marcia Hafif commence à émerger. J’ai quand même enseigné, mais très peu, à New York et à Genève.
La Suisse cultive une longue tradition de peinture abstraite. En Suisse romande, en particulier, des artistes comme Francis Baudevin, Christian Floquet ou Stéphane Dafflon ont bâti l’essentiel de leur carrière en travaillant sur le monochrome. Des peintres plus jeunes se lancent aussi dans cette aventure – je pense à Frédéric Gabioud ou à Sylvain Croci-Torti. Croyez-vous qu’à notre époque ce genre de peinture soit encore un sujet, un enjeu de l’art ?
C’est vrai qu’en Suisse romande, la situation est un peu particulière. John Armleder, les écoles de Genève (la HEAD) et de Lausanne (l’ECAL) et moi, nous avons sans doute installé une forme de tradition. Cela dit, dans chaque école d’art, il y aura toujours un étudiant qui peindra un monochrome. Parce que c’est quelque chose de possible. Et je trouve cela très bien.
La moto est indissociable de votre identité. Vous vous prenez en photo dessus. Vous avez filmé un road-trip de plus de trois heures, parcourant la Californie en Harley pour voir toutes les pièces de land art. Qu’est-ce qui vous plaît dans la vie de biker ?
Au début, j’aimais l’objet. J’ai acheté ma première moto à Paris 4.000 francs. C’était une Harley que je trouvais très belle. Peu à peu, je suis entré dans la culture biker. À New York, je rencontre Indian Larry, qui réalisait des customs [personnalisations] incroyables. Je lui propose d’exposer ses créations avec mes toiles en me disant que, s’il y avait des motos posées devant, les gens regarderaient peut-être mes tableaux. Indian s’est tué sur la route, et j’ai oublié cette histoire. L’exposition a finalement eu lieu avec les gens qui avaient repris son garage. Plus tard, je me suis mis en tête de construire une Harley à partir de rien. C’était pour l’exposition en plein air organisée à Môtiers, en Suisse, tous les cinq ans. La moto a ensuite été montrée à la Fiac [à Paris], où elle a été vendue.
Au vernissage de votre rétrospective, le Mamco a fait venir le chanteur Christophe pour mixer vos paroles sur des sons électroniques. En son temps, Jacques Higelin avait composé Le Minimum, une chanson sur vous. Quel rapport entretenez-vous avec la musique ?
Dans les années 1960, j’étais un peu snob. J’écoutais [Karlheinz] Stockhausen et Pierre Boulez. Il y avait bien sûr les Beatles, auxquels il était difficile d’échapper. Même Paul McCartney est venu voir notre première exposition, de Buren, Parmentier, Toroni et moi. Cela avait excité tout le monde, sauf moi qui m’en fichais un peu. C’est la moto qui m’a vraiment ouvert au rock. Tucson [Arizona] est une ville de musique, j’y ai produit des disques avec des groupes du coin. On a même fait une tournée, le Cactus Tour, auquel le groupe Calexico a participé. Christophe, je ne le connaissais pas avant. Le Centre d’art de Neuchâtel (CAN) lui avait demandé de poser de la musique sur une conversation que j’avais eue avec les responsables du lieu. C’est à cette occasion que je l’ai rencontré. Il est drôle. Il vit la nuit comme une rock-star dans son studio d’enregistrement, entouré de ses guitares et de sa collection de juke-box. Et il porte un véritable intérêt à la peinture contemporaine.
Vous résidez à côté de Tucson, en plein désert. Alors que vous revendiquez une liberté absolue dans tout, n’est-ce pas compliqué de vivre dans un pays où la politique envers les émigrés et les étrangers n’a jamais été aussi dure ? D’autant que vous habitez littéralement à la frontière mexicaine…
C’est vrai que ce n’est pas simple tous les jours. Les États-Unis restent néanmoins un pays vaguement démocratique. Si j’étais plus jeune, peut-être que je partirais. Cela dit, j’ai un projet artistique à ce sujet. Je n’en dis pas plus. Depuis que j’ai été arrêté à Paris, j’ai appris à me taire…

